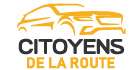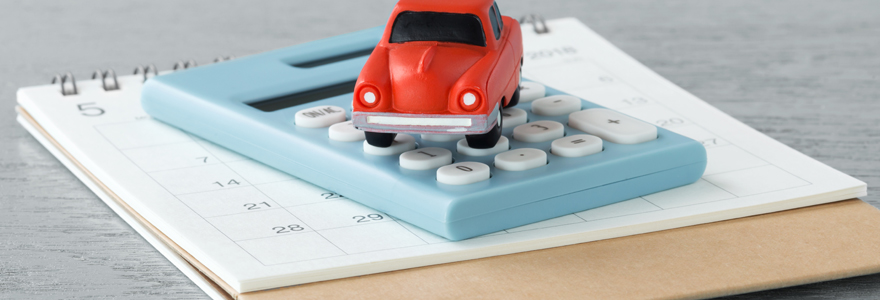
Et voilà, le contrat assurant votre voiture vient d'être résilié par votre assureur car vous avez eu un incident de paiement. Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul à faire face à ce problème ! Pour autant, ce motif de rupture peut avoir de lourdes conséquences pour la suite de votre vie d'assuré. Vous risquez notamment d'avoir des difficultés à trouver un professionnel qui accepte votre dossier ! Comment devez-vous agir si vous vous retrouvez dans une telle situation ? De quels recours disposez-vous réellement ? Vous le saurez en prenant connaissance des informations contenues dans le texte ci-dessous.
Différentes causes possibles
Vous auriez tord de penser que ce genre d'erreurs n'arrive qu'aux autres. Il existe en effet une multitude de cause pouvant conduire à une telle situation. Si vous avez l'habitude de régler votre cotisation mensuelle via un prélèvement automatique sur votre compte bancaire, il est tout à fait possible qu'un tel acte soit refusé par votre banquier en raison un dépassement de la limite du découvert mensuel autorisé. Rares sont en effet les assurés à vérifier chaque mois que leur prélèvement n'ait pas fait l'objet d'un incident.
Vous pouvez également avoir changé d'établissement bancaire ou de compte récemment. Par conséquent, la compagnie d'assurance ne pourra pas effectuer le prélèvement nécessaire au règlement des cotisations. Elle ne connaîtra pas en effet vos nouvelles coordonnées bancaires et considérera donc que vous êtes en faute. Enfin, vous pouvez avoir des difficultés financières passagères qui vous obligent à décaler le paiement de certaines factures. Si telle est votre situation, préférez prendre contact avec votre assureur afin de l'en avertir. Ces derniers se montrent souvent à l'écoute et évitent alors de lancer une procédure.
Vous aimeriez obtenir des précisions supplémentaires à propos de ce sujet passionnant ? Dans ce cas, allez de ce pas consulter le site www.assuranceendirect.com ! Vous pourrez même obtenir, directement en ligne, des devis en provenance des partenaires de la plate-forme. De quoi vous donner un sérieux coup de pouce pour vos recherches !
https://www.acommeassure.com/retrouver-assurance-auto-resiliation-non-paiement
La mise en demeure
Le code régissant ce marché, et plus particulièrement son article L113-3, prévoit que l'assuré dispose de dix jours maximum à compter de la date d’échéance pour régler sa prime d’assurance. On parle alors de mise en demeure de payer. Ne commettez surtout pas l'erreur de négliger cet avertissement. Il est en effet fortement conseillé de prendre au plus vite contact avec la compagnie et de préférence par écrit. Si vous vous retrouvez dans une telle situation, expliquez pourquoi vous ne pouvez payer vos cotisations et proposez un échéancier précis pour le règlement de votre dette ou, encore mieux, joignez un premier acompte. Ce geste sera grandement apprécié et démontrera votre volonté de résoudre ce litige au plus vite. Si le délai de dix jours est dépassé ou sans réponse de la part de l'assuré alors la compagnie peut lancer véritablement la procédure.
La première étape consiste à rappeler à l'assuré les engagements stipulés dans son contrat ainsi que le montant des sommes dues. Ce dernier reçoit alors une lettre recommandée avec accusé de réception. Dès réception de cet envoi, l'assuré dispose alors d'un nouveau délai de trente jours pour régler sa dette. Si une solution n'est pas trouvée, votre contrat sera immédiatement résilié et le litige sera alors porté devant la justice. En effet, malgré la fin de votre engagement, vous demeurez malgré tout redevable du montant des cotisations non payées. La compagnie peut également se réserver le droit de demander en plus l'application des intérêts légaux selon l'importance des sommes et des retards.
Pourquoi est-ce si difficile de s'assurer par la suite ?
Après une résiliation, la plupart des conducteurs rencontre des difficultés à retrouver un assureur. Pourtant, vous n'êtes pas un mauvais conducteur puisque vous ne comptez aucun sinistre dans lequel votre responsabilité a pu être engagée. Pourquoi alors essuyez-vous autant de refus ?
La réponse est simple mais reste pourtant méconnu du grand public. Lorsqu'une compagnie rencontre un incident de paiement avec l'un de ses clients, elle communique l'ensemble des informations le concernant (dont son identité) à l'Association pour la Gestion des Informations sur le Risque en Assurance (AGIRA). Cette entité est chargée de centraliser les données transmises par toutes les compagnies. Ces dernières disposent également d'un droit absolu de consultation des dossiers. C'est pourquoi, elles sont immédiatement informées dès qu'un client potentiel ayant vu l'un de ses contrats être résilié pour faute de règlement les sollicite. Cependant, la loi limite la durée de conservation de ces données. Elles sont archivées durant deux ans au maximum à compter de la date effective de résiliation du contrat. Après ce laps de temps, l'AGIRA doit nécessairement les détruire.
Défendez vos droits si nécessaire !
Si malgré tous vos efforts, aucune compagnie ne donne une issue favorable à votre demande, ne désespérez surtout pas. Il vous reste en effet une ultime possibilité de vous sortir de ce mauvais pas. N'oubliez pas qu'être couvert est un droit légitime pour tout conducteur. Pour le faire valoir, vous allez devoir vous adresser au BCT (Bureau Central de Tarification). Cette instance est la seule qui puisse obliger une compagnie à vous compter parmi ses clients. Cependant, ne croyez surtout pas qu'il s'agisse d'une solution parfaite.
Tout d'abord, vous devez savoir que ce recours nécessite une certaine patience. Comptez jusqu'à trois mois pour obtenir une réponse. Ensuite, vous ne pourrez prétendre qu'à un contrat courant sur une année seulement. Vous allez donc devoir renouveler vos recherches dès la fin de l'année en cours. Enfin, il ne vous sera délivré qu'une protection auto minimale (au tiers). Comme vous le savez, celle-ci ne convient pas à tous les conducteurs ni à tous les véhicules...